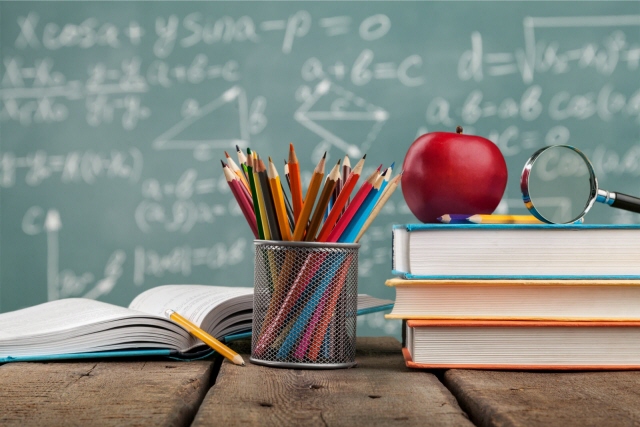Le sort des enfants scolarisés pose plusieurs types de problèmes. D’abord, on peut noter que se rendre en classe est une démarche imposée aux mineurs âgés de 3 à 16 ans (C. éducation, art. L. 131-1, modifié par la loi n° 2019-791 du 26 juill. 2019) mais qu’il est possible de faire l’école à la maison, sachant toutefois que ces démarches sont bien encadrées afin de soutenir au mieux les familles et leurs enfants. Du neuf a été apporté en la matière par le décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 (I). Ensuite, si être concerné par l’instruction à domicile peut présenter quelques inconvénients, ce n’est rien à côté des drames qui se vivent parfois en milieu scolaire, harcèlements, violences, voire accidents (II). Il importe de bien soutenir les victimes et tout faire pour éviter ces drames car, aller à l’école, ne doit pas être vu comme une situation dangereuse. En outre, de récentes études ont montré aussi que les fournitures scolaires, voire les jouets, peuvent contribuer au mal-être des jeunes enfants et il est fort important que les produits dangereux aient pu être repérés (III). Enfin, pour bien soutenir les parents et leur éviter de faire face à de trop grosses difficultés financières, le législateur a mis en place depuis plusieurs années le versement de l’allocation de rentrée, le montant des aides et le plafond des ressources ayant été revus en prévision de la reprise des cours (IV).
I – Le retour en classe des élèves, sauf exceptions
Tous les ans, à compter du mois de septembre, les enfants quittent leur domicile pour démarrer une année scolaire dans leur classe, entourés de leurs camarades et encadrés par leurs enseignants. En effet dès 3 ans (depuis la rentrée de septembre 2019) les enfants doivent être scolarisés et ce, jusqu’à leur 16e anniversaire, l’instruction étant donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Certes, cette obligation ne saurait aller jusqu’à contraindre les parents à mettre leur enfant malade ou handicapé à l’école. Ce sont des situations où les cours sont parfois prévus dans les établissements de soins, sachant qu’en fonction de l’état de l’enfant, le retour en classe est souvent impossible. En effet, des bâtiments inadaptés, un manque de soins ou encore des méthodes pédagogiques inadéquates conduisent à exclure les enfants handicapés ou vulnérables des bancs de l’école. Une situation beaucoup moins grave vise les enfants dont les parents militent pour les maintenir chez eux et leur faire classe à la maison. Encore faut-il que la décision de faire l’école sans aller en classe ne soit pas prise à la légère. Certes, ce type d’enseignement permet aux mineurs d’apprendre à leur rythme et sans la pression du groupe scolaire ou des enseignants, toutefois il est essentiel que les parents aient connaissance du cadre légal qui entoure l’école à la maison, sachant que les modalités scolaires ont été modifiées par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 (JO du 25 août) confortant le respect des principes de la République. Il revient aux parents de valider leur demande d’autorisation auprès de la DSDEN (Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale). Si cette autorisation leur est accordée, ils peuvent faire le choix de l’instruction en famille (IEF) et ils se chargent alors d’instruire leurs enfants et de façonner leurs cours ou désignent une personne de leur choix.
Ce qui a changé au fil des années c’est qu’il ne suffit plus de faire une simple déclaration mais que l’école à la maison est dorénavant soumise à un régime d’autorisation préalable. En effet, en vertu du décret n° 2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille, à compter de la rentrée scolaire 2022-2023, pris en application des articles L. 131-2 et L. 131-5 du Code de l’éducation, modifiés par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, la possibilité de recevoir une instruction à domicile est soumise à l’obtention d’une autorisation préalable permettant à l’enfant de pouvoir suivre l’école à la maison, les arguments évoqués tenant à l’état de santé de l’enfant ou à son handicap, à la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, à l’itinérance de la famille ou à son éloignement de tout établissement scolaire ou encore à l’existence d’une situation propre au mineur.
Cette demande est à adresser au Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN) du département de résidence de l’enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire pour laquelle la famille souhaite opter pour cette forme d’instruction. De nouvelles précisions ont été apportées par le décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 afin de préparer la rentrée scolaire 2022-2023. Ce texte a modifié l’article D. 131-11-10 du Code de l’éducation, à la suite d’une décision rendue par le Conseil d’État (CE, 16 mai 2022, Association unie et autres, n° 463123, 463224 et 463324), les juges ayant suspendu le décret alors applicable qui limitait à 8 jours la possibilité pour les familles de faire un recours. Il est désormais prévu que lorsque les familles ont déposé une demande qui n’a pas abouti, face à une décision de refus d’autorisation, elles peuvent former un recours devant la commission présidée par le recteur. Sur la base du nouveau décret, les demandes d’autorisation présentées pour l’année scolaire 2022-2023 et les suivantes sont envisageables dans un délai porté de 8 à 15 jours (C. éducation art. D. 131-11-10). Il est important que les parents soient informés de cette augmentation du délai pour qu’ils puissent former un recours devant la commission présidée par le recteur et ainsi solliciter à nouveau l’autorisation d’instruire leur enfant en famille.
II – La lutte contre les drames vécus en milieu scolaire
Aller en classe fait du bien aux enfants et les aide à grandir. Néanmoins, ils ne sont pas à l’abri de problèmes et peuvent être victimes de dommages causés par leurs camarades, leurs professeurs ou le personnel administratif travaillant dans les écoles.
Tout doit être fait pour sécuriser les lieux et empêcher que les enfants soient victimes de violences ou d’accidents, les professionnels étant formés en ce sens. Cela n’empêche pas que des drames surviennent, des élèves étant malmenés, blessés ou oubliés. Récemment les juges ont sanctionné une auxiliaire de puériculture qui avait fermé une crèche en oubliant un petit enfant dans les locaux (CAA Marseille, 12 mai 2022, n° 21MA01009, Les Affiches d’Alsace et de Lorraine, n°48, 17 juin 2022, p. 4) ; il en irait de même si le personnel scolaire agissait de la sorte. Par ailleurs, les cours d’école sont souvent le théâtre d’accidents et quand un enfant est victime d’une bousculade ou d’une agression provenant d’un camarade, ses parents doivent mettre en œuvre la responsabilité des parents de l’auteur des faits dommageables (C. civ., art. 1242, al. 4), cette responsabilité étant aussi toujours couverte par une assurance. En effet, la simple participation d’un enfant mineur à la réalisation du dommage suffit pour engager un recours contre ses parents, lesquels sont civilement responsables. Il se peut aussi que la responsabilité de l’État et des communes soient engagées quand le dommage survient dans la cour de récréation ou dans les locaux de l’école. Une action en responsabilité contre l’État peut être intentée devant les tribunaux judiciaires lorsque le préjudice est imputé à une faute commise par un membre du personnel enseignant mais aussi devant la juridiction administrative s’il découle d’un défaut d’organisation du service public de l’enseignement. Rappelons à l’approche de la rentrée scolaire au personnel qu’il est indispensable de bien appréhender les risques juridiques susceptibles d’être en lien avec des accidents scolaires.
Néanmoins en cas de survenance de difficultés, si des actions en responsabilité peuvent être engagés pour obtenir notamment des dommages et intérêts, il n’est pas toujours évident pour les parents de savoir comment agir, face à des accidents, des violences ou des harcèlements scolaires (loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, JO du 3 mars). Précisément en cas de harcèlement causé par un membre de l’enseignement public, des précisions sont apportées par le Code de l’éducation (art. L. 911-4). Selon ce texte, quand la responsabilité d’un membre de l’enseignement public est engagée à l’occasion d’un fait dommageable commis au détriment d’un élève, la responsabilité de l’État doit être substituée à celle dudit membre.
Lors d’une affaire dans laquelle un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) avait été accusé de harcèlement moral contre dans son établissement, le harcèlement étant aggravé du fait que les deux victimes de ses propos et comportements, mineurs scolarisés dans l’école où il exerçait ses fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles avaient moins de 15 ans, la question s’est posée de savoir si ce texte était applicable. Pour la Cour de cassation, un ATSEM est bien un membre de l’enseignement public dans la mesure où sa mission a une vocation éducative (Crim. 2 févr. 2022, n° 21-82.535). En conséquence, sur le fondement de l’article L. 911-4 du Code de l’éducation, l’agent qui avait harcelé deux jeunes écoliers durant son temps de travail a été poursuivi à tort par leurs familles. Il aurait fallu qu’elles agissent contre l’État et non contre l’auteur des faits.
Pour la chambre criminelle de la Cour de cassation, « l’action en responsabilité, exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droits, intentée contre l’État, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et est dirigée contre l’autorité académique compétente ». En effet, ce texte substitue la responsabilité de l’État à celle du membre de l’enseignement public, lequel ne peut pas être lui-même mis en cause devant les tribunaux par la victime ou ses représentants. Les ATSEM appartiennent effectivement à la communauté éducative parce que les missions qu’ils ont à remplir sont bien à connotation éducative. Précisément, ils doivent accueillir les élèves, mettre en place des dispositifs d’assistance pédagogique et de surveillance et prendre soin des élèves lors des activités scolaires ou périscolaires. Les agents communaux qui travaillent dans les écoles sont en conséquence à considérer comme des membres de l’enseignement public pendant le temps scolaire et périscolaire puisqu’ils appartiennent à la communauté éducative et qu’ils se voient confier une « mission d’accueil des élèves, d’assistance pédagogique et de surveillance ».
Désormais, dans des affaires similaires, on pourra faire état de harcèlement scolaire, violence qui peut être verbale, physique ou psychologique, puisque la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire (JO du 3 mars) est entrée en vigueur. En effet, le harcèlement scolaire, à savoir harcèlement moral commis à l’encontre d’un élève, est devenu un délit pénal pour tenter d’éviter que les écoliers aient à subir ce genre d’atteintes. Il est essentiel que les enfants suivent une scolarité sans harcèlement scolaire (C. éducation, art. L. 511-3-1, issu de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, JO, 28 juill.) et il faut rassurer les parents sur ce point.
III – Les vérifications à mener concernant les fournitures scolaires
Tout doit être fait pour assurer la sécurité des élèves et des études ont été menées récemment pour alerter sur certains dangers causés par des fournitures scolaires, des substances dangereuses ayant été détectées.
Un communiqué de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) du 7 juillet 2022 a effectivement révélé que les crayons, stylos, surligneurs, tubes de colle... ne sont pas forcément inoffensifs pour les écoliers. Les études menées par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), l’UFC-Que Choisir, 60 millions de consommateurs et le Danish EPA ont précisément noté la présence de composants allergisants, irritants et de substances chimiques dangereuses dans toutes ces fournitures, qu’elles soient utilisées à l’école, au bureau ou à la maison. Le problème vient du fait que, du fait de leur jeune âge, les écoliers sont plus susceptibles de mettre en bouche leurs fournitures scolaires et qu’ils sont plus exposés à la nocivité des produits ingérés, inhalés ou simplement en contact avec la peau. Leur santé peut donc être menacée.
Pour éviter des drames, il faut conseiller aux personnels scolaires et aux familles de faire leur choix de fournitures scolaires en regardant avec attention les étiquettes, pour repérer des marquages, des labels environnementaux et des pictogrammes de danger. Selon le communiqué de l’Anses, il est dès lors regrettable que, pour l’heure, « ni en France ni en Europe, les fournitures scolaires ne relèvent d’une réglementation spécifique permettant d’encadrer leur composition, leur fabrication ou leur utilisation pour s’assurer de leur innocuité ». Compte tenu de la multitude des fournitures scolaires pouvant être utilisées en milieu scolaire et des substances chimiques volatiles ou semi volatiles souvent présentes dans certains produits, il faudrait aussi mieux surveiller la qualité de l’air dans les écoles.
Dans le même ordre d’idées, de nouvelles substances parfumantes, telles que l’extrait de mousse de chêne, ou l’heptine carbonate de méthyle, à l’odeur de violette, sont interdites dans les jouets pour enfants depuis le 5 juillet 2022. Par ailleurs, plus de 70 autres substances susceptibles de provoquer des allergies doivent être explicitement signalées lorsqu’elles sont incorporées à des jouets ou jeux pour enfants. Ces dispositions ont été prévues par l’arrêté du 7 janvier 2022, JO du 17 février, modifiant l’arrêté du 24 février 2010 fixant les modalités d’application du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets et elles sont entrées en vigueur le 5 juillet 2022 pour que l’on puisse tenir compte des possibles effets allergisants dès la rentrée 2022-2023.
IV – Le soutien financier accordé aux parents
Depuis de nombreuses années, les familles dont les enfants vont à l’école sont soutenues matériellement par le versement de l’allocation de rentrée, afin de les aider à faire face aux dépenses de rentrée (fournitures scolaires, matériel, vêtements). Elle est automatique due quand les parents remplissent les conditions liées à l’âge des écoliers, étudiants ou apprentis (rémunérés à moins de 950 euros), lesquels doivent avoir entre 6 et 18 ans, à l’inscription dans un établissement ou un organisme d’enseignement public ou privé ou en cas d’inscription auprès d’un organisme d’enseignement à distance (en revanche les instructions à la maison sont exclues) et aux plafonds de ressources, lequel dépend du nombre d’enfants à charge (on prend en compte les revenus de l’année N-2, à savoir pour la rentrée 2022-2023, ceux de 2020). Afin de tenir compte de l’inflation, une revalorisation des montants a été mise en place pour la rentrée 2022 (392,05 € par enfant âgé de 6 à 10 ans et enfant plus jeune inscrit en CP ; 413,69 € par enfant âgé de 11 à 14 ans et 428,02 € par enfant âgé de 15 à 18 ans). Quant aux plafonds de ressource, ils dépendent du nombre d’enfants : pour 1 enfant, 25370 euros, pour 2, 31225 euros, pour 3, 37068 et pour chaque enfant supplémentaire, 5855.
Certaines familles rencontrent toutefois des difficultés, notamment quand le couple parental a rompu. Ainsi, alors qu’une résidence alternée avait été mise en place, un père de famille s’est vu refuser ce versement par la CAF (CA Poitiers, 5 mai 2022, n° 20/00309). En effet, s’il est admis qu’en cas de résidence alternée un partage par moitié de la charge des enfants est envisageable pour le calcul des allocations familiales (CSS, art. L. 521-2, al. 2) et que les parents peuvent désigner d’un commun accord un allocataire unique ou se voir chacun reconnaître la qualité d’allocataire, rien n’est prévu pour les autres prestations familiales. Il convient alors de déterminer quel est le parent qui a la charge des enfants, ce dernier étant désigné en tant qu’allocataire unique (CSS, art. R. 513-1). Par voie de conséquence, l’allocation de rentrée scolaire ne peut être versée qu’au parent ayant la charge des enfants le jour de la rentrée scolaire (CSS, art. R. 543-1),
En complément, un soutien financier peut aussi être accordé aux communes dans un contexte scolaire. En effet, conformément à l’article L. 212-8 du Code de l’éducation, les enfants étant soumis à l’obligation scolaire, en cas d’inscription d’un enfant dans une école hors de sa commune de résidence, la prise en charge des frais de scolarité repose sur un accord : « lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence ». L’alinéa 4 de ce texte précise toutefois que la commune de résidence de la famille n’est pas tenue de contribuer financièrement à cette scolarisation « si la capacité d’accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d’accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune ». Il en va de même (alinéa 5) quand « les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par voie réglementaire ». Il faudrait peut-être revoir ces règles, notamment pour soutenir des communes rurales et préserver l’existence de leur école (en ce sens, Rép. min. à QE no 37157, JOAN Q. 22 mars 2022, p. 1894).
Pour préparer la rentrée, il est un peu tard mais l’accompagnement des élèves se fait tout au long de l’année et il faut garder présent à l’esprit l’intérêt des enfants pour qu’ils continuent de bien aimer aller à l’école. C’est la classe d’aller en classe.