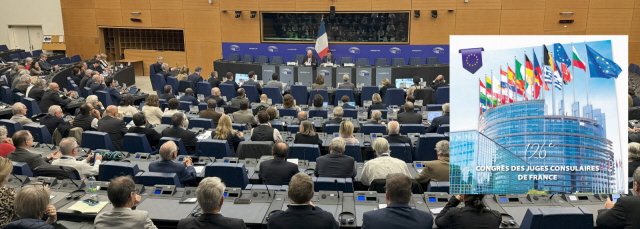Monsieur Tony Fasciglione, président de la Compagnie des juges consulaires au tribunal judiciaire de Strasbourg a organisé cet événement d’envergure nationale. Il revient sur les propos échangés pour les lecteurs des Affiches d’Alsace et de Lorraine.
Quel a été le principal enseignement tiré des échanges avec vos homologues européens (Suisse, Belgique, Italie, Allemagne) sur la place de la justice consulaire ?
T. Fasciglione : L’élément le plus marquant est la présence de juges consulaires dans tous ces pays. Cela démontre l’essence même de notre rôle à savoir l’apport de la sphère économique à la justice commerciale.
Dans chacun des pays rencontrés, la justice commerciale fait appel à des juges issus du monde économique. Cependant, des différences subsistent, notamment concernant la rémunération : la France est un peu en retard sur cet aspect, où les juges consulaires sont bénévoles, contrairement à d’autres pays où des formes d’indemnités existent.
L’importance de l’approche consulaire a été fortement étayée par le professeur Julien Théron (Université Paris I Panthéon-Sorbonne). Il a rappelé que, depuis l’époque romaine, les commerçants sont jugés par d’autres commerçants. Surtout, il a souligné que pour qu’elle soit «juste», la justice ne peut pas reposer uniquement sur des éléments de droit, elle doit s’appuyer également, ce sont les termes qu’il a employés, sur de l’intuition et de l’expérience.
C’est là que l’échevinage (la collaboration entre juges de carrière et juges issus du monde économique) trouve toute sa pertinence, permettant de conjuguer la maîtrise du droit avec l’intuition et l’expérience.
La réalité économique est celle d’un marché unique, avec des litiges impliquant des sociétés allemandes, des créanciers belges, etc. Comment peut-on améliorer la coordination et la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires au sein de l’Union européenne ?
T. Fasciglione : Il existe une organisation, l’Union européenne des magistrats consulaires (UEMC), dont je suis un des administrateurs, qui tente d’harmoniser les pratiques. Cependant, nous sommes au stade du dialogue, et non à celui d’imposer une uniformisation. Chaque pays applique ses propres lois, et l’harmonisation se fait plus dans un état d’esprit commun que par des textes législatifs unifiés à ce stade, sauf stipulations contractuelles spécifiques.
Y a-t-il des propositions concrètes pour l’harmonisation, notamment en matière de prévention des difficultés transfrontalières ?
T. Fasciglione : Non, pas à ce stade sur le plan strictement transfrontalier. Toutefois, un thème central a clairement émergé de ce congrès : l’importance que vont prendre toutes les procédures amiables. C’est vraiment le sens de l’histoire, d’aller vers l’amiable. Qu’il s’agisse de la conciliation, de la médiation ou des Audiences de Règlement Amiable (ARA), la volonté générale est de faire de l’amiable avant de faire du judiciaire. Nous glissons vers une approche où l’on cherche à prévenir plutôt qu’à sanctionner ou simplement «dire le droit».
Quelles sont les grandes propositions de réforme du Livre VI du Code de commerce qui émergent des travaux de la commission ?
T. Fasciglione : L’esprit général est la simplification et l’accent mis sur la prévention. Nous devons déconstruire le «mille-feuille» législatif. Les propositions concrètes (détaillées plus bas) visent tout d’abord à renforcer l’efficacité des procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation). Par exemple, en limitant le mandat ad hoc à quatre mois, prorogeable jusqu’à douze mois maximum, dans un souci de simplification. Mais également à insister sur la prévention. Ainsi, la prévention des difficultés des entreprises est désormais une préoccupation centrale de la justice. Le rôle du juge évolue : de juge rigide appliquant le droit, il devient aussi celui qui cherche l’accord, la conciliation.
Autre grand sujet traité durant ce congrès : L’Intelligence Artificielle. Comment peut-elle concrètement aider les juges consulaires dans leur mission ?
T. Fasciglione : L’IA va impacter nos vies et nos professions, mais il ne faut pas craindre qu’elle remplace le juge. Une phrase clé résume cette perspective : «L’IA proposera des décisions, mais ne prendra pas les décisions.» L’IA sera une aide formidable en permettant d’accéder aux données et à la jurisprudence en quelques secondes, au lieu de plusieurs heures. L’Open Data, loué par le président Soulard (NDLR : Premier président de la Cour de cassation) pour son ouverture et sa transparence, est la matière première de l’IA pour l’aide à la décision. L’IA sera un outil de base, mais restera un outil.
Quels sont les principaux défis éthiques et juridiques soulevés par l’intégration de l’IA dans la justice commerciale ?
T. Fasciglione : Les problématiques sont énormes et concernent principalement l’éthique et la confidentialité. Tout d’abord, la confidentialité des données. En effet, l’IA conserve les informations. Lorsque l’on interroge un modèle sur un dossier, les données mises en jeu (noms de sociétés, magistrats) sont collectées. Cela pose un réel problème éthique, d’autant que la base de la prévention des difficultés est la confidentialité. L’anonymisation des données devient indispensable.
Un autre élément est l’impartialité ou le manque de visibilité du traitement des données. En effet, qu’est-ce qui garantit que l’IA est impartiale ? Si l’algorithme est piraté ou biaisé, les jurisprudences qu’il propose en masse pourraient influencer la décision du juge, qui se fierait à l’outil. C’est un vrai danger car la machine peut trier des données sans que l’utilisateur n’en ait conscience.
Ainsi l’IA va modifier le fonctionnement du travail du juge consulaire, l’accélérer, mais le rôle central de l’humain doit rester préservé. Comme nous l’avons dit plus haut, l’expérience humaine reste fondamentale. Le juge consulaire doit conserver son libre arbitre et sa capacité analytique personnelle face aux propositions de l’IA.
C’est là que son office prend tout son sens ; dans la décision finale, juste et équilibrée, qui va au-delà d’un simple algorithme.
La Conférence générale des juges consulaires a confié à une commission de travail la mission de réfléchir à une réforme du livre VI du Code de commerce (procédures collectives et de prévention des entreprises en difficulté).
Constats de la commission
Après audition de nombreux praticiens (magistrats, avocats, professeurs, mandataires, etc.), la commission arrive aux constats suivants :
Il y a tout d’abord un problème d’intelligibilité et de lisibilité. En effet, depuis la loi dite loi Badinter de 1985, le livre VI a connu une vingtaine de réformes, dont les récentes transpositions de la directive européenne Insolvency II (2021) et la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante (2022). L’accumulation et l’interférence du droit européen nuisent à l’intelligibilité et à la lisibilité des textes, ce qui décourage les chefs d’entreprise (TPE/PME) et réduit l’attractivité du droit français pour les investisseurs.
On assiste également à une prolifération des procédures. Le nombre de procédures de traitement des difficultés (hors prévention) est passé de trois (en 1985) à sept actuellement (sauvegarde, sauvegarde accélérée, RJ, LJ, LJ simplifiée, rétablissement professionnel, traitement de sortie de crise), auxquelles s’ajoutent celles pour l’entrepreneur individuel. Ce nombre désoriente les chefs d’entreprise.
Enfin, la construction complexe du Livre VI. Celui-ci est organisé autour de la procédure de sauvegarde (la moins utilisée) comme procédure pivot, à laquelle renvoient le redressement et la liquidation judiciaires pour leurs principales dispositions. Cette structure complique la compréhension de chaque procédure individuelle.
Principes directeurs de la refonte
Face à ces constats, la commission prône une refonte profonde du livre VI autour des principes suivants :
- Maintenir l’équilibre entre les droits du débiteur, des salariés et des créanciers.
- Conserver la notion de cessation des paiements et introduire une notion complémentaire de capacité de rebond laissée à l’appréciation du juge.
- Simplifier en réduisant le nombre de procédures.
- Réorganiser le livre VI pour une meilleure lisibilité, en éliminant les nombreux renvois.
- Renommer le Redressement Judiciaire en « restructuration » et la Liquidation Judiciaire en « cessation d’activité » (termes moins stigmatisants).
- Accélérer le déroulement des procédures et confier de nouvelles responsabilités au juge-commissaire.
- Créer une procédure spécifique pour les très petites entreprises (plus de 90 % des entreprises) : rapide et axée sur le traitement des dettes auprès des principaux créanciers.
- Revoir le traitement des difficultés de l’entrepreneur individuel.
Propositions détaillées de la commission
La commission propose des mesures de simplification, des réécritures d’articles et la création de nouvelles procédures (cadre général défini, légistique à élaborer).
Pour les procédures amiables de prévention, la commission propose de :
- Maintenir le mandat ad hoc (simplicité d’usage) et intégrer les spécificités du règlement amiable agricole dans la conciliation.
- Encadrer la succession de mandats ad hoc et de conciliations dans une durée maximale de douze mois. La durée initiale (pour les deux) serait limitée à quatre mois, renouvelable par périodes maximales de quatre mois sur requête motivée. Le dispositif préventif ne pourrait être renouvelé avant un délai de trois mois.
- Clarifier l’article L. 611-7 al.5 sur les délais imposés par le juge à un créancier récalcitrant. Limiter le recours contre la décision d’ouverture d’une conciliation à l’appel du ministère public. Améliorer le contrôle du coût global de la procédure de conciliation.
- Favoriser la cession prénégociée (Prepack Cession) : exclure sa mise en œuvre dans le cadre du mandat ad hoc. Améliorer le contrôle en instituant le juge ayant ouvert la conciliation garant de la régularité de la présélection des repreneurs.
Réorganisation du Livre VI
La commission propose de regrouper les règles générales applicables à toutes les procédures dans un titre spécifique et de rassembler les dispositions visant le rebond de l’entrepreneur individuel dans un titre unique.
Le nouveau Livre VI serait structuré en sept titres principaux ainsi libellés :
- Titre I Procédures amiables de prévention ;
- Titre II Règles générales applicables aux procédures de traitement des difficultés ;
- Titre III Procédures de sauvegarde judiciaire ;
- Titre IV Procédure de restructuration judiciaire ;
- Titre V Procédure de cessation d’activité judiciaire ;
- Titre VI Procédures applicables à l’entrepreneur individuel ;
- Titre VII Sanctions.
Propositions pour les autres procédures
Concernant les procédures de sauvegarde, la commission préconise tout d’abord le maintien de la sauvegarde accélérée (issue d’Insolvency II) pour le traitement précoce des difficultés. Elle serait aménagée pour éviter les effets excessifs d’abandons de dettes imposés aux créanciers par l’application forcée interclasses.
Elle propose ensuite la création de la sauvegarde simplifiée (TPE). Il s’agit de créer une nouvelle procédure de sauvegarde simplifiée (semi-collective), réservée aux entreprises d’au plus dix salariés et avec un passif inférieur ou égal à trois millions d’euros. Cette procédure serait courte (quatre mois) ciblant uniquement les dettes auprès des principaux créanciers (fisc, social, banques, bailleur...). Enfin, elle serait accessible aux TPE, qu’elles soient ou non en état de cessation des paiements.
Pour la procédure de restructuration, procédure qui vise à traiter les difficultés structurelles, la commission préconise qu’elle intègre les éléments structurants de la sauvegarde et du redressement judiciaire actuels, avec des modalités distinctes selon la situation du débiteur à l’ouverture :
- Débiteur non en cessation des paiements : Application des dispositions de la sauvegarde actuelle.
- Débiteur en cessation des paiements / à son initiative : Application des dispositions du redressement judiciaire actuel (avec aménagements).
- Débiteur en cessation des paiements / Assigné ou Requête Parquet : Ouverture d’une procédure de restructuration comportant des modalités plus contraignantes.
La commission propose de réduire la période d’observation à deux périodes de quatre mois au lieu de six, prorogeable exceptionnellement d’une troisième période de même durée.
Dans le cadre d’une procédure de cessation d’activité, la commission envisage :
- Le maintien d’un professionnel (liquidateur) pour encadrer la procédure, quelle que soit la taille de l’entreprise.
- Une procédure Unique : revenir à une seule procédure (Cessation d’activité) destinée aux seules personnes morales. Le tribunal examinera l’éligibilité à une procédure rapide selon les critères actuels de la liquidation simplifiée.
- L’accélération de la Clôture. Il s’agit d’étendre la désignation d’un mandataire ad hoc pour la poursuite des instances en cours et la réalisation d’actifs résiduels. Propositions de réduction des délais.
Pour les procédures applicables à l’entrepreneur individuel, il est proposé que le tribunal ne traite que le passif professionnel, en écartant toute interférence avec le patrimoine personnel et qu’une nouvelle procédure unique soit créée et dénommée « procédure de rebond » avec trois orientations possibles :
- Rebond avec plan d’apurement partiel et effacement du reliquat de dettes (pour ceux qui souhaitent rembourser en partie).
- Rebond avec effacement complet des dettes (sous conditions strictes, pour les très petits patrimoines, sans dessaisissement, poursuite de l’activité possible).
- Rebond avec cessation d’activité (semblable à celle des personnes morales, avec dessaisissement des biens professionnels, créanciers invités à déclarer leurs créances).
En ce qui concerne les sanctions, les propositions portent uniquement sur les sanctions civiles du tribunal de commerce.
- Responsabilité pour Insuffisance d’Actif : Maintenir un régime spécial de responsabilité du dirigeant (articles L. 651-1 s. C. com.) pour clarifier les règles. Remplacer la répartition au marc l’euro entre tous les créanciers par la règle normale de répartition de la procédure collective.
- Faillite Personnelle et Interdiction : Fusionner la faillite personnelle et l’interdiction de gérer pour ne garder qu’une seule sanction professionnelle intitulée « interdiction de gérer ».
La commission a également travaillé sur les délais de procédure en partant du constat que ces délais n’ont pas été aménagés depuis quarante ans. L’objectif est donc de limiter la durée d’une procédure de restructuration (plan de continuation) à douze mois (objectif réaliste : huit mois) et réduire également les délais de clôture des procédures de cessation d’activité avec un objectif à douze mois. Il s’agit donc pour la commission de gagner du temps grâce à une plus grande exigence sur l’obtention des informations de la part du débiteur et des organes de la procédure à chaque étape clé.
Le dernier point abordé est le rôle du juge-commissaire. Pour la commission, il faut tout d’abord renforcer les pouvoirs du juge-commissaire, notamment en supprimant la notion de « contestation sérieuse » pour le rendre compétent pour toutes les contestations de créances (dans la limite de compétence du tribunal). Elle préconise aussi la possibilité de désigner des co-juges-commissaires et la faculté de substitution par une formation collégiale (dont il ferait partie). Elle propose aussi que Le juge-commissaire puisse se substituer au tribunal pour certaines décisions non litigieuses (ex : constats d’impécuniosité). Enfin, pour la commission, il faut institutionnaliser la pratique des « réunions de juge-commissaire » dans le livre VI.