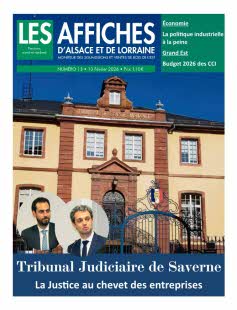Hérault Tribune : Votre livre “Le grand défi de l’eau”, qui doit sortir le 3 septembre, est contre les discours alarmistes. Pourtant, on le voit dans l’Hérault, la situation hydrique est inquiétante, avec dès le mois de juillet des zones en alerte renforcée sécheresse…
Éric Servat : Je ne nie pas les difficultés. Mais on peut être lucide sans être alarmiste ou catastrophique, ce qui a tendance à décourager et à ne laisser aucun espoir. Il ne faut pas mentir aux gens sur les difficultés, c’est inutile. Mais il faut leur expliquer que cela nous oblige à ne jamais renoncer. Nous avons les moyens de mettre en face des solutions aux changements qui nous attendent. Des milliers de gens travaillent au quotidien. Par exemple, au Centre Unesco de l’eau de Montpellier, une fédération de 18 laboratoires de recherche travaille tous les jours, réfléchit, essaie d’analyser ce qui se passe afin de mettre au point des procédés technologiques. Mais aussi de faire prendre conscience aux gens de la situation en leur donnant envie de changer et de participer à l’adaptation qui est nécessaire.
Quel est l’état du département de l’Hérault, qui a été très pluvieux au printemps mais qui a déjà connu plusieurs vagues de chaleur précoces ?
Depuis fin mai, il ne pleut plus et on a des épisodes de vent importants. Au-delà de la sécurité et des problèmes d’incendie que ça peut générer, ça dessèche la végétation et les sols. Tout le département de l’Hérault est a minima en situation de vigilance sécheresse, avec des endroits comme le canal du Midi ou à la frontière avec le département de l’Aude, qui sont déjà en alerte renforcée. Les pluies de printemps ne sont pas les plus utiles parce que la végétation redémarre et capte l’essentiel de l’eau. Le plus intéressant, ce sont les pluies d’automne et d’hiver qui rechargent les nappes.
Comment expliquer que le département de l’Hérault soit dans cette situation ?
Ça s’explique par le changement climatique. Le climat méditerranéen a été décrit comme ayant des étés chauds et secs. Aujourd’hui, ils sont plus chauds, plus secs et plus longs.
Comment le cycle de l’eau est alors bouleversé ?
Le cycle de l’eau a accéléré. Plus il fait chaud, plus l’eau va s’évaporer et donc plus vous desséchez les sols et la végétation. En même temps, la température de l’atmosphère augmente. Et plus elle est chaude, plus elle peut stocker de la vapeur d’eau. Autant d’eau qui ne va pas retomber de manière régulière mais qui retombera à l’automne, au moment des événements méditerranéens et cévenols qui étaient déjà par nature assez violents. Mais là, vous allez mettre à disposition de ces événements des masses d’eau potentielles plus importantes puisque vous aurez stocké plus de vapeur d’eau.
Est-ce que la situation de sécheresse peut venir de l’utilisation intensive ou inadaptée des ressources en eau ?
Il y a une utilisation qui est inévitable. Pour l’agriculture et la viticulture, on ne fait rien sans eau. Après il y a le tourisme. Mais si vous l’enlevez à l’économie de l’ancien Languedoc-Roussillon, ça va faire un sacré manque à gagner à la fin de l’année. Donc il faut qu’on arrive à s’organiser autrement. Il faut que chaque goutte soit utilisée de la manière la plus optimale possible.
Est-ce que l’eau est suffisamment prise en compte dans notre société ?
Très clairement non. Il faut que chacun redécouvre l’importance de l’eau. Remettre l’eau à sa place permettra de sensibiliser et d’utiliser l’eau sans excès. On fait un gros travail de sensibilisation, notamment avec les plus jeunes en milieu scolaire pour qu’ils fassent plus attention à l’eau qu’il ne le faisait jusqu’à présent. Une fois que vous avez à nouveau intégré le fait que l’eau est un sujet essentiel, vous êtes prêt à fournir des efforts.
Quelles sont les solutions à mettre en place ?
Cette ressource est utilisée par tous. Aucune de nos activités se fait sans eau. Il faut que chacun en prenne conscience, se parle et fasse des compromis en acceptant de ne pas avoir 100% de ce qu’il estime être nécessaire pour lui. La base, c’est de faire preuve d’intelligence collective et d’accepter la notion de compromis.
Concrètement, comment il va falloir changer ?
Il va falloir que l’agriculture et la viticulture modifient un certain nombre de pratiques. Il faut trouver des plantes ou des espèces de plantes qui soient moins consommatrices d’eau et plus résistantes à la chaleur. Il faut aussi que les industriels s’adaptent et recyclent l’eau qu’ils utilisent, tout en travaillant sur une dépollution en amont. Ça va devenir une obligation.
Ce qui est très peu fait pour l’instant en France…
Effectivement mais on voit que ça bouge. L’année dernière je suis allé inaugurer une station de traitement des eaux dans une entreprise en Bretagne qui consommait énormément d’eau et s’est engagée dans des systèmes de recyclage d’eau utilisée. Ils ont fait un investissement très coûteux et aujourd’hui, ils consomment moins d’eau alors que l’entreprise est en pleine croissance.
Quelle est la responsabilité des pouvoirs publics ?
Il faut avoir les bonnes orientations en matière de politiques publiques et travailler sur la mise au point de certaines. Il y a des démarches qui sont en cours sur les problématiques de pollution, d’utilisation de la ressource ou de rationalisation de l’utilisation de la ressource. Les politiques publiques sont souvent assez lentes à mettre en oeuvre parce qu’elles travaillent sur des secteurs qui nécessitent des investissements importants qui ne peuvent pas être réalisés du jour au lendemain. On ne peut pas demander à un agriculteur de tout changer en 6 mois. On ne va pas demander à une entreprise de mettre en place des systèmes de recyclage de l’eau qu’elle utilise en 6 mois. Ça nécessite du temps. Mais les pouvoirs publics ont cette obligation de définir un cadre qui doit évoluer pour aller dans le sens de ce que la science dit à travers les trajectoires et les scénarios qu’elle propose en matière d’impact du changement climatique.
Les processus sont longs… Est-ce qu’il n’est pas trop tard pour agir ?
Il n’est jamais trop tard pour agir. Il faut au contraire se retrousser les manches et travailler. On n’a qu’une seule obligation, c’est l’action. On a identifié des difficultés, on est capable de construire des scénarios sous plusieurs hypothèses. On a donc la capacité d’action, en faisant évoluer les cadres réglementaires, les pratiques dans les milieux agricole et industriel, ou en sensibilisant les gens dans leurs actions personnelles.
Pour les entreprises vous avez évoqué le recyclage de l’eau. Mais il y a aussi la réutilisation des eaux usées. Est-ce que c’est une potentielle solution ?
Absolument. La réutilisation, c’est une récupération de l’eau en sortie de station de traitement des eaux usées qu’on va réutiliser ailleurs. Aujourd’hui, compte tenu de la pression sur la ressource naturelle, il faut essayer de préserver l’eau potable : on n’a pas besoin de l’utiliser pour le nettoyage des rues, l’arrosage des espaces verts publics, l’hydrocurage des réseaux ou les réserves contre les incendies. Donc l’eau réutilisée sera nécessaire mais on ne peut pas le faire partout parce que dans nos régions, en plein été, si vous enlevez du cours d’eau ce qui sort de la station de traitement des eaux, il n’y a plus grand chose dans le cours d’eau et tout l’écosystème est fragilisé. Sur notre littoral, l’eau est rejetée dans la mer dans la plupart des cas donc on peut très bien la récupérer et la réutiliser. Mais derrière ça nécessite des investissements dans des canalisations pour amener l’eau là où on en a besoin.
Et l’autre solution, c’est la désalinisation mais qui a ses défauts comme la pollution et la surconsommation d’énergie. Est-ce que la recherche évolue ?
Il ne peut pas y avoir de tabou ni d’a priori quand on est en difficulté. Pendant trop longtemps, la désalinisation a été taboue. Ça consomme de l’énergie donc on ne regarde pas. Mais on peut mettre au point des systèmes qui vont être moins consommateurs d’énergie. Effectivement, le rejet de saumure (résidu salé) perturbe l’environnement mais on peut travailler pour résoudre ce problème. J’ai des collègues ici à Montpellier qui travaillent pour améliorer ces techniques de désalinisation. Ils ont abandonné les techniques qui consistent à chauffer l’eau avant de la condenser. Ils travaillent avec des membranes qui permettent de retenir le sel et qui sont beaucoup moins énergivores : il y a déjà 20 à 25% d’énergie en moins de consommée. Ils vont continuer à chercher parce qu’à un moment donné on aura besoin de ces technologies.
Dans l’Hérault, quatre retenues d’eau ont été validées par le conseil départemental, un projet très controversé. Qu’est-ce que vous en pensez ?
Au-delà des méga-bassines, c’est le stockage d’eau qui est devenu tabou. C’est absurde d’imaginer qu’on ne va pas stocker de l’eau. Mais on ne peut pas le faire n’importe comment, ni n’importe où.
Pourquoi ? Quels sont les critères ?
C’est la nappe dans laquelle vous allez chercher l’eau. Si vous avez une nappe qui est inertielle, c’est-à-dire qui va se remplir à une vitesse extrêmement lente, c’est absurde d’aller y pomper de l’eau puisqu’elle va mettre un temps incroyable à se recharger. En revanche, si vous avez des nappes qui sont très réactives qui se remplissent et se vident rapidement, ça a du sens de récupérer de l’eau. En France, on stocke entre 5 et 6% de ce qui circule dans l’ensemble du réseau hydrographique français – contre 50% en Espagne. Mais le stockage a de l’intérêt si c’est adapté à votre contexte, à votre sous-sol et à votre régime de précipitations.
Vous avez évoqué plusieurs solutions scientifiques. Est-ce que vous ne seriez pas techno-solutionniste ?
À partir du moment où vous dites science et technologie, vous êtes immédiatement taxés de techno-solutionniste. Mais je ne crois pas l’être, parce que précisément, je crois qu’il faut redonner sa place à l’eau dans nos sociétés et changer notre regard et notre culture. Si vous n’avez pas d’eau, vous ne pouvez rien développer. Si les gens ne sont pas sensibilisés, vous pouvez développer toutes les approches techniques et scientifiques que vous voudrez, ça ne marchera pas.
Et c’est pour ça que vous avez écrit votre livre ?
Oui, j’ai voulu toucher un grand public. C’est pour raconter l’histoire de l’eau et rappeler que l’eau est notre quotidien. Si vous oubliez les gens, si vous êtes uniquement focalisés sur de la technique, rien ne se passera. Toutes les solutions que vous amenez, elles n’auront d’intérêt que si vous les avez mises en place en pensant d’abord à l’histoire, aux gens, à leur culture et leurs traditions. Sans ça, vous êtes à côté de la plaque. En revanche, on ne résoudra pas les problèmes sans la science.