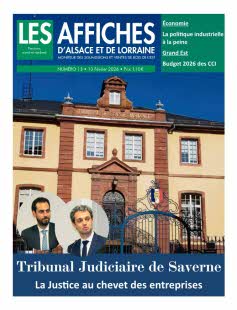- Les Affiches d’Alsace et de Lorraine : Vous êtes en fonction depuis 9 mois. Est-ce que vous pouvez vous présenter, parler de votre parcours, votre spécialité ?
- Me Christine Salanave : « Je suis avocate à la cour d’Appel. C’est une des spécificités locales, je ne postule et ne plaide que devant la cour d’Appel de Metz. Je suis une ancienne. J’ai prêté serment en 1981. Je travaille au sein d’un cabinet où nous sommes trois associés, et où chacun a ses petites particularités. J’ai passé mon examen pour être avocate à Paris, je suis arrivée à Metz en 1970. »
- Me François Battle : « Je suis né en 1969 à Metz, je suis Mosellan, marié et père de quatre enfants. J’ai prêté serment en 1995, je suis généraliste en première instance avec une dominante immobilière, pénal et protection sociale. En province on est le plus souvent généraliste. »
- Le barreau de Metz possède un effectif autour de 350 avocats dont une trentaine à la cour d’Appel. Est-ce toujours le cas ?
- F.B. : « C’est pareil. À la cour d’Appel, ils ne sont plus que 23 ou 24. Avec cette particularité au barreau de Metz, il y a une parité exacte hommes-femmes. C’est un hasard, ce n’est pas un sujet. C’est un barreau de cour, on a un grand volume d’avocats en instance, moins à la cour. On est un barreau très compétent en procédures d’appel par ses spécificités. Indépendamment des spécificités du droit local, comme les avocats à la cour ont le monopole de représentation, ils font ça à titre principal. En première instance on est un barreau jeune. Le vieillissement de la population n’existe pas chez nous. »
« Un paradoxe remarquable »
- C.S. : « à Metz il y a des promotions d’une dizaine d’avocats, régulièrement. »
- F.B. : « Il faut le relever, c’est une profession qui ne permet plus de s’enrichir ! Les avocats sont en grande souffrance. Il y a un paradoxe remarquable : il y a beaucoup de souffrance au travail, mais il y a un grand enthousiasme à exercer cette profession. On peut parler de résilience… Pourquoi ? En réalité on est la seule profession dont le coeur de métier, ce sont les gens et on est protégé par la loi, le secret professionnel, l’indépendance. Il y a ce triptyque : On s’intéresse aux gens par le droit, on est gardien d’un secret protégé par la loi, et indépendant constitutionnellement, ça maintient toujours un enthousiasme malgré les difficultés tant économiques que sociales. »
- Une fois dans la réalité du métier, ça change la donne ?
- F.B. « Oui, mais on a un barreau très chaleureux. C’est un peu comme l’athlétisme que j’ai pratiqué : c’est un sport qui se pratique seul, mais on est bien entouré. Certes, il y a une concurrence, mais quand il y a un souci, il y a les confrères. Ce n’est pas familial, mais il y a une vraie confraternité. Et notre barreau est à taille humaine. »
- C.S. : « On s’y sent bien. On est quand même un corps. À Strasbourg il y en a 1000, ce n’est pas pareil. »
- Êtes-vous assez nombreux vu le volume des affaires ?
- F.B. : « Je ne peux pas vous répondre. Il n’y a personne qui se plaint de ne pas trouver d’avocat. Sur l’activité pénale, ça ne dépend pas de nous, mais de la politique pénale. Sur l’activité civile, la procédure permet de traiter les dossiers dans un temps, disons acceptable. »
- Est-ce que cette souffrance professionnelle impacte le recrutement, l’attractivité du métier ?
- F.B. : « Économiquement on paie le prix de l’appauvrissement de la population qui ne fait que s’aggraver. Le domaine assisté augmente, tout ce qui est aide judiciaire. Or l’aide judiciaire ne rémunère pas l’avocat, ne fait que le défrayer. Cela permet de payer les charges. »
- C.S. : « On l’indemnise, on ne le paie pas. De fait, les charges pèsent de 60 à 70% dans nos cabinets. »
- F.B. : « Il n’y a pas que l’État. Il faut s’équiper, il y a des frais de sécurité électronique, de téléphonie, des locaux, un loyer, des frais de secrétariat. La numérisation génère des coûts. »
-C.S. : « Ce qui fait que bon nombre de jeunes avocats assurent eux-mêmes le secrétariat. »
« On en a assez des réformes en permanence ! »
- F.B. : « Voilà un peu le contexte. Pour autant, c’est divers, c’est varié, les confrères rencontrent des gens. Mais dans le même temps, et ça on le partage avec les magistrats et les greffiers : on en a assez des réformes en permanence. Et ça n’arrête pas. Il n’y a pas de stabilité juridique. On n’a pas le temps de s’adapter à une réforme, une autre arrive. C’est épuisant. Quand on est juriste, on est censé manier un outil, que l’on est censé savoir utiliser. On ne peut pas nous demander de nous former à un outil et d’en changer rapidement, avant qu’on ait pu s’y faire. L’État a la volonté de faire des économies sur la justice, et un des moyens qu’il trouve est de mettre des règles contraignantes pour faire pression sur le monde judiciaire, plutôt que de donner des moyens, il prend le temps. Les justiciables pensent que la justice est trop longue, en réalité, les magistrats et les avocats n’ont pas le temps, parfois, de traiter les dossiers de manière satisfaisante. C’est paradoxal. »
- Vous avez des exemples ?
- F.B. : « Les avocats sont tenus par des règles de procédures de produire rapidement des actes et comme il y a de nombreuses procédures, les magistrats n’ont pas le temps de rendre des décisions assez vite. Et on ne peut le résoudre que par une augmentation des moyens. »
- Et qu’en est-il du justiciable ?
- F.B. : « On est dans un contexte d’exigence des personnes. Les particuliers sont très difficiles à satisfaire. Les moyens de communication sont immédiats. Il y a une pression. »
- Est-ce que beaucoup quittent le métier ?
- C.S. : « Oui. C’est un phénomène qu’on observait pas du tout il y a 25 ans. Les gens ne quittaient pas la profession. Aujourd’hui, au bout de 5, 8 ou 10 ans d’exercice, ils partent. Ils sont épuisés, ce sont des burn-out, ils estiment que ce n’est pas assez rentable, ils ne gagnent pas leur vie. »
- F.B. : « Le seul marqueur qu’on a au barreau, c’est quand les confrères ne paient plus leur cotisation. Nous sommes des anciens. Mais les jeunes générations sont prêtes à changer de métier plusieurs fois dans leur vie. En fait, les avocats sont de gros travailleurs. Ils aiment les gens, et ne manquent pas de traiter de gros dossiers. »
-C.S. : « Ce n’est pas que le cas de notre profession, c’est un phénomène plus général. Il y a plusieurs explications possibles, ce n’est pas que l’aspect économique qui génère cette situation. »
« Défendre les confrères »
- Quelles ont-été vos premières actions dans votre projet de bâtonnier ?
- F.B. : « C’est un projet permanent : défendre les confrères. On est inscrit dans les barreaux de province, avec un attachement à ce qui fait notre profession, un serment, la déontologie, on n’aime pas trop la déréglementation, ce n’est pas protecteur, ni des avocats ni des personnes. On est attachés aux ordres séparés. On regarde d’un mauvais oeil l’idée d’un ordre national. Cette notion d’autonomie, d’indépendance, on la reproduit dans notre ordre, on en est les gardiens. Je suis un bâtonnier qui défend l’avocat de province. »
- Donc opposé au barreau de Paris ?
- F.B. : « J’ai compris ça assez rapidement comme bâtonnier, le barreau de Paris crée des problèmes. Ils veulent déréglementer, ils sont très libéraux, parce qu’ils ne contrôlent pas leurs confrères. Ils sont trop nombreux : c’est presque la moitié du barreau français, autour de 35 000 confrères. En province on est à dimension humaine, on se connaît, c’est plus facile pour l’entraide. »
« Faire une Maison de l’avocat »
- Vous avez des projets matériels ?
- F.B. : « On commence à regarder un autre lieu pour faire notre Maison de l’avocat qui permettrait de centraliser les moyens avec notre salle bonne chose. Mais une Maison de l’avocat où il y a tout, le bâtonnier, son bureau, l’accès au conseil de l’ordre, c’est un bon projet. Mais on ne quitte pas pour autant le palais de justice. »
- Est-ce que vous vous êtes réparti les missions du bâtonnier ?
- V.S : « Il y a une répartition naturelle, tribunal, cour d’Appel. On se complète. »
- F.B. : « On utilise le fait qu’on est à deux. Il y a des dossiers avec une première lecture de l’un, puis une de l’autre, on est moins seul. On s’entend bien. On a des compétences séparées par nos pratiques, qui nous permettent de maîtriser ce petit monde. »
- Quels sont vos dossiers prioritaires ?
- F.B. : « C’est de défendre mes confrères, parce tous les jours des gens se plaignent de la justice. On veille aussi à ce que nos confrères soient excellents. »
-C.S. : « Et la porte du bâtonnier est toujours ouverte. On est là aussi pour entretenir de bonnes relations avec les chefs de juridiction. Il faut mettre de l’huile dans tous ces rouages. »
« Bâtonnier, on prend de la hauteur »
- F.B. : « On a de bonnes relations avec les magistrats. On n’a pas le choix. Ils ont les mêmes problématiques que nous, toujours contraints de s’adapter aux réformes. »
- Est-ce qu’un mandat de deux ans pour l’Ordre est long, ou trop court ?
- C.S. : « Mais ça passe très vite. »
- F.B. : « C’est bien pour un avocat d’être bâtonnier. On sort de notre cabinet, on travaille une autre matière, le droit professionnel. On commence à avoir une autre dimension, on prend un peu de hauteur. En tant que bâtonnier, on a en charge une petite collectivité, c’est très enrichissant. La tradition à Metz est que les bâtonniers sortants sont membres de droit du conseil de l’Ordre. C’est important, avec l’expérience, on peut donner un avis, rappeler certaines règles. »
- C.S. : « J’ai été pour ma part déjà vice-bâtonnier. C’était il y a treize ans. Notre conseil de l’Ordre est particulièrement jeune, on a besoin de gens d’expérience. »
- F.B. : « On a un super conseil de l’Ordre à Metz. Des gens bénévoles, on leur demande n’importe quoi, ils sont tout de suite volontaires, diligents. Ils arbitrent des contestations d’honoraires, font des enquêtes sur un confrère qui s’installe… ou qui se retire de la profession. »
« Les gens ont besoin d’une bulle de certitude… »
- Est-ce qu’il y a des évolutions marquantes qui auraient un impact sur votre métier? Quel est votre avis sur les modes alternatifs de règlement des différends, les MARDS ? Sur le développement de l’amiable ?
- F.B. : « J’ai une position un peu tranchée sur la question. La médiation, c’est une façon de déléguer la justice à des gens qui n’ont ni formation spécifique, ni déontologie. Et c’est payant. En plus on transforme une justice gratuite, en une justice qui est de moins en moins gratuite. Ce qui me dérange, c’est que les justiciables ont besoin que leurs difficultés soient tranchées. Dans un monde complètement chaotique, ils ont besoin d’une bulle de certitude, d’autorité. Pourquoi les institutions fonctionnent, parce que derrière, les gens savent qu’il y a de la légitimité, de l’autorité et de la compétence. Jusqu’à présent, le magistrat a la légitimité et l’autorité. Les gens respectent toujours l’idée du juge qui a l’autorité et la légitimité. Si vous enlevez ça, vous allez faire perdre à la justice, cette notion-là, plus une notion d’exactitude.»
- Les mesures alternatives n’ont pas cette autorité, cette légitimité ?
- F.B. : « Je n’en suis pas sûr. Bon, le droit vous donne raison, mais ça va durer longtemps, trouver un accord. On est dans la négociation, dans le commerce. La justice n’est pas le commerce. On applique des règles de droit. Il faut savoir où la règle permet de trancher, où la règle est insuffisamment bien rédigée pour qu’elle ne résolve pas une difficulté : c’est simple ! Dans nos cabinets on fait déjà beaucoup d’amiable. On est les premiers acteurs à ne pas faire de procès. On se fait concurrencer par des gens qui n’ont ni la compétence, ni la formation, ni la déontologie et qui ne sont pas soumis au secret professionnel. »
« Il y a un risque de déjudiciarisation… »
- C.S. : « Je suis d’accord avec François quand on assiste à une déjudiciarisation. On va transférer tous les litiges à un médiateur, un conciliateur, des gens qui ne sont pas formés. Ce que veulent les justiciables, en cas de litige, est d’être bien défendus et qu’il soit tranché par un professionnel… et que ça aille vite. On leur dit, vous allez pouvoir vous arranger et vous trouverez vous-mêmes la solution à votre litige. Le problème, c’est que les décrets tombent : on est obligé d’appliquer les nouvelles règles pour instaurer la médiation. Elles s’imposent à nous, nous sommes des professionnels du droit : on est obligé de prendre le train en marche. Notre rôle est d’accompagner nos clients dans ces mesures de médiation. Il ne faut pas les systématiser. Il y a des domaines où c’est utile, en matière familiale probablement, mais pas pour tout. Quand il s’agit de régler un montant de pension alimentaire, je ne vois pas ce qu’un médiateur vient faire là-dedans. Dans des litiges voisins, d’accord, mais en matière de construction, je ne vois pas, il y a des règles de droit à appliquer : entre le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre, les compagnies d’assurance, je ne vois pas comment on pourrait mettre tout le monde autour d’une table. Il y a un risque de déjudiciarisation pour soulager la justice : malheureusement les décrets sont là, il faut qu’on les applique. Nous devons alors assister nos clients dans les processus de médiation. Certains magistrats n’y sont pas non plus très favorables, et ça peut rallonger les procédures. »
- F.B. : « Nous sommes formés spécifiquement parce qu’on a une déontologie liée à notre profession, un serment particulier, une indépendance absolue. Et ça n’existe nulle part ailleurs ! On est les seuls à défendre et à conseiller les particuliers, les entreprises et les justiciables. Je regrette, la justice ne doit pas se déplacer dans le commerce. »
- La médiation est peut-être une étape pour un accès au droit plus facile ? Vous êtes partenaire du CDAD (centre départemental d’accès au droit) ?
- F.B. : « Il faut y aller pour ne pas avoir accès au droit en France. On est là pour ça. Quand bien-même on ne le serait pas, aucun avocat ne ferme sa porte à quiconque veut l’ouvrir. Le CDAD, c’est une bonne chose, tant que ça ne fait pas concurrence aux avocats. Tant que les associations ne jouent pas un rôle qui n’est pas le leur. Cela permet à des personnes, qui n’ont pas de moyens de transport, d’avoir un accès. C’est bien pour ça qu’on est partenaire. Nous-mêmes sommes présents dans le territoire. Le jour où ce ne seront plus les avocats qui délivreront des conseils, mais des associations, des juristes recrutés… Et ça commence. Il y a des associations de défense de consommateurs qui recrutent des juristes qui interviennent dans le cadre de ces consultations. C’est à la marge. Aujourd’hui, les avocats vont partout dans les consultations au sein des Maisons de droit. »
- C.S. : « Cela dit, les Maisons du droit offrent cette proximité avec les justiciables. »
« L’IA est un outil efficace »
- Dans votre quotidien, que va vous apporter l’Intelligence artificielle ?
- F.B. : « Pour moi l’IA n’est pas un problème. C’est même un outil, disons, sympathique. On va plus vite. On est censé savoir ce que dit la jurisprudence : on allait dans les bibliothèques, consulter des ouvrages mis à jour, qu’on fouille… Si un arrêt est rendu un mois avant, on ne le saura pas. L’IA nous permet d’avoir accès à une information juridique, de manière synthétisée, assez vite. L’IA a cette qualité d’analyser différentes sources pour en tirer une synthèse. »
- Donc elle vous facilite le travail ?
- F.B. : « Je vais mettre un bémol. On est au milieu : on a été éduqué à l’ancienne. On a ces nouveaux outils et on est prudent. On vérifie si c’est juste, par notre expérience, par nos propres dossiers, pour être sûr que ce qui nous est dit est juste. L’IA, ce n’est pas de l’intelligence, c’est du brassage. Si on se transporte dans le temps : ce sera l’IA contre l’IA ! On aura plus besoin de l’humain : c’est un monde dystopique. Quand on doit convaincre, construire une décision, il faut apporter des preuves, des éléments techniques, des témoignages, de l’ingénierie : il faut bien à un moment donné une intervention humaine, elle joue un rôle de métabolisation d’éléments factuels, non juridiques. On comprend l’âme des gens, leurs sentiments, leur existence, on prend tout et on en fait une matière adossée à une règle de droit pour convaincre le juge de dire, vous avez raison. Dans cette galaxie de règles, il y a un petit espace, pour que le juge puisse, par équité, privilégier telle règle ou telle règle. Le danger de déshumanisation est une théorie. J’entends des gens qui commencent à se retirer de tout, ne s’informent plus. »
- Mais ça change votre quotidien ?
- F.B. « Oui. L’IA est un outil de recherche surpuissant. C’est redoutablement efficace. Tant mieux. D’ailleurs le barreau de Metz a investi un outil pour tous les confrères. Il vient de prendre en charge un outil d’intelligence artificielle jurisprudentiel pour que les confrères puissent y avoir accès. C’est important et c’est du concret. »
- Quel est votre regard sur la place du droit local ? Sur sa préservation ?
- F.B. « Les dispositions du droit local sont bonnes, pour preuve, elles sont exploitées en France. Ainsi, la clause de non-concurrence en matière de droit du travail, ce n’était que du droit local. Sur un contrat de travail, cette clause n’était valable que si elle était rémunérée et limitée dans le temps et dans l’espace. C’est la jurisprudence de la Cour de cassation qui l’a dit : c’est devenu la loi. Ici on a le Livre foncier, l’héritage d’un mécanisme allemand sur la propriété foncière. Il est plus efficace, de mon point de vue, que la conservation des hypothèques. Il est gouverné par un juge, il y a des registres, c’est numérisé. En droit du travail, il y a quelques spécificités. »
- C.S. : « Historiquement on y est attaché, il n’est jamais remis en cause. On a un Institut du droit local à Strasbourg qui le défend bien. »
« Le barreau de Paris veut modifier la gouvernance »
- Lors de l’assemblée générale de juillet, une résolution portait sur le secret professionnel ? A-t-elle été adoptée ?
- F.B. : « C’est le barreau de Paris qui est derrière cette résolution. Il veut faire entrer dans la profession, les juristes d’entreprise. Ce qui n’est pas concevable du point de vue des barreaux de province. Il faudrait pour cela, changer le champ du secret professionnel. Pour l’instant, l’État nous permet toujours de nous autoréguler, de nous auto-contrôler. Les Ordres sont gardiens de ça. On est attachés à ça, pour éviter de perdre notre indépendance et notre secret professionnel. »
- Qu’en est-il de la grande consultation des barreaux lancée l’an dernier ?
- F.B. : « Une usine à gaz qui avait juste pour objectif caché de modifier la gouvernance des barreaux, pour de nouveau porter atteinte et que le barreau de Paris prenne le contrôle du CNB, le conseil national des barreaux, et modifie ainsi la profession. Il y a deux blocs, la conférence des bâtonniers qui fédère l’ensemble des bâtonniers de province, et le barreau de Paris. »
« Conserver notre indépendance »
- Quels sont pour vous les défis de la profession dans l’avenir ?
- C.S. : « Conserver notre indépendance. Ce sera dur. »
- F.B. : « Le poids de l’État devient insupportable. Il y a la pression libérale, et la pression de l’État. Il en va de l’indépendance de la justice. Il faut savoir que, depuis un certain temps, des magistrats ont renoncé à dire qu’ils sont un pouvoir constitutionnel. Ils arrivent à dire qu’ils ne sont qu’une autorité. Ils perdent de vue que la justice est un des trois pouvoirs constitutionnels. Elle se réduit à n’être qu’une autorité. Ce sont des signes. »
- Quels messages voulez-vous faire passer à vos confrères ?
- F.B. : « Être avocat, c’est à la fois le pire métier et le meilleur métier du monde. Tous les avocats auraient besoin de parler un peu, parce qu’on est détenteur de secrets et on ne peut pas les confier. »
-C.S. : « Et on a toujours dans un petit coin de notre cerveau, une liberté de penser. »
- F.B. : « On est un des rares métiers où subsiste le droit à l’indignation. Notre liberté d’expression est particulièrement protégée. »
- Où en est le projet de crèche lancé par vos prédécesseurs ?
- F.B. : « Elle existe et fonctionne. C’est un partenariat avec la MAM, la Maison d’assistants maternels de Metz, où l’on peut réserver des berceaux. Et ça marche. »